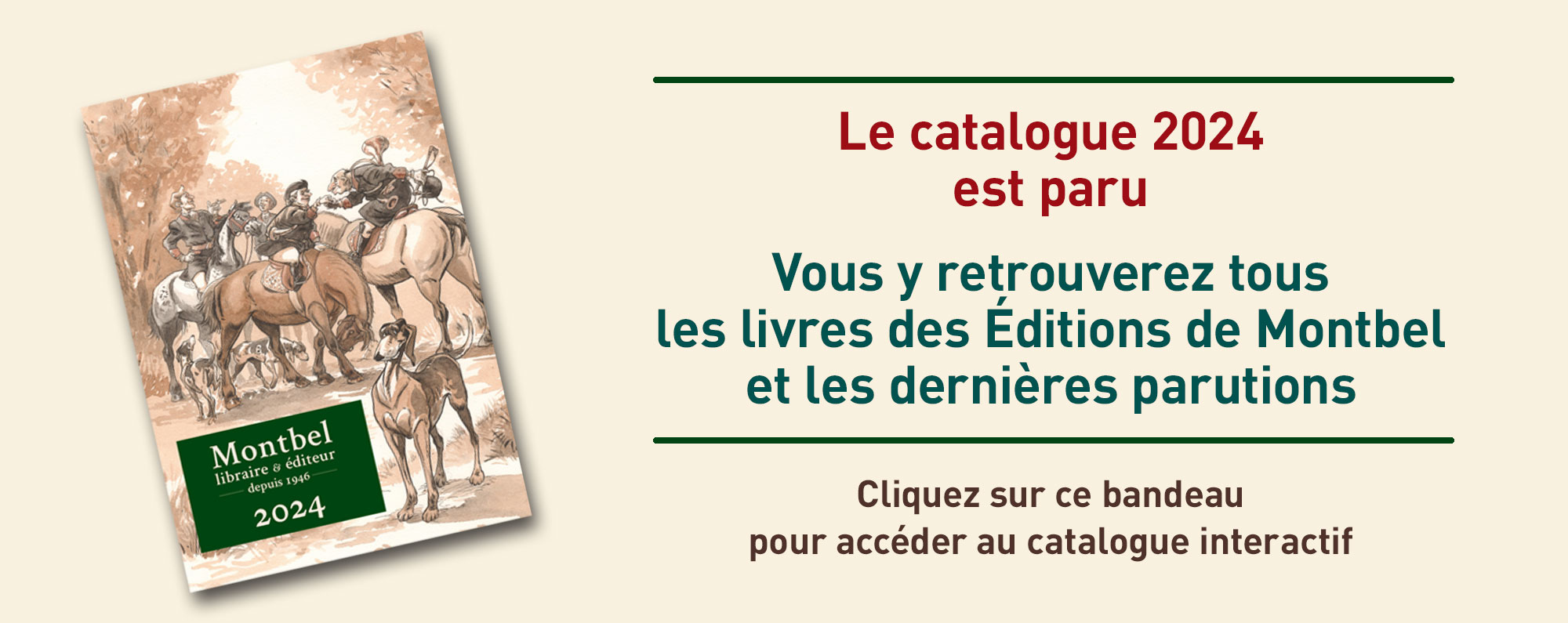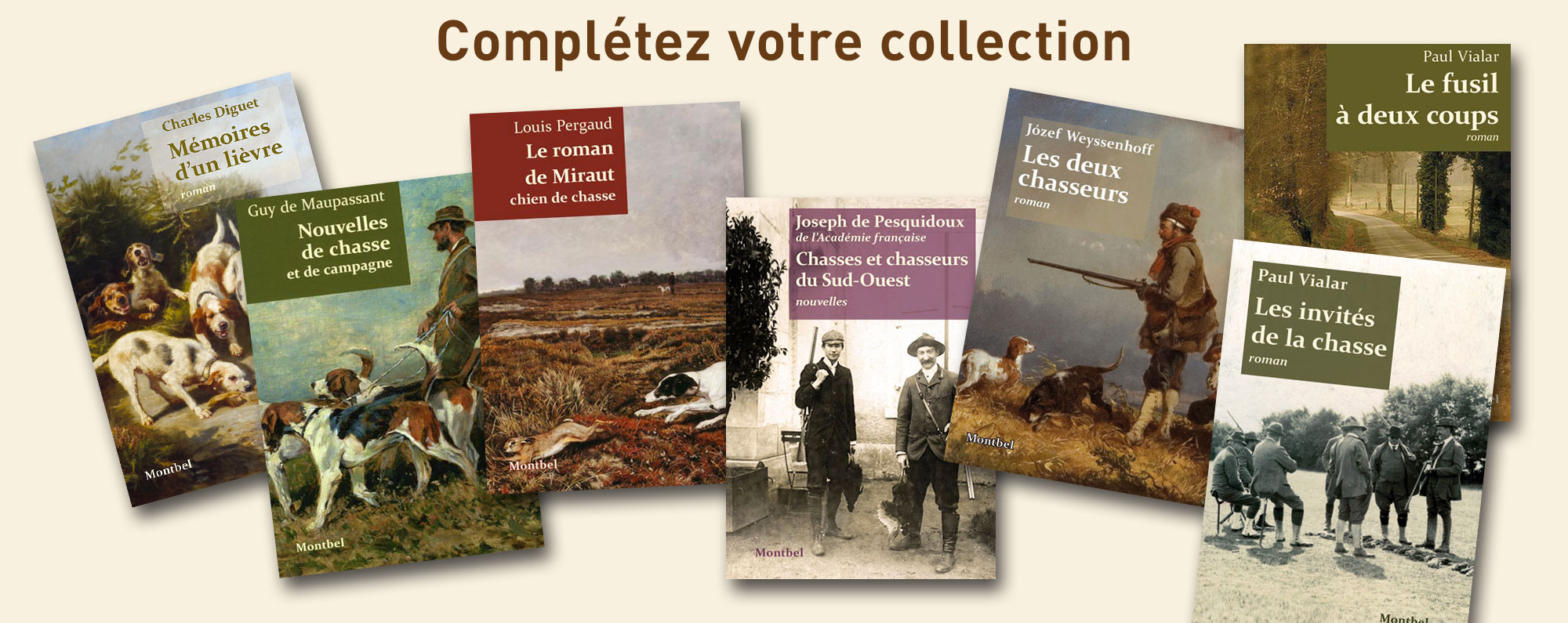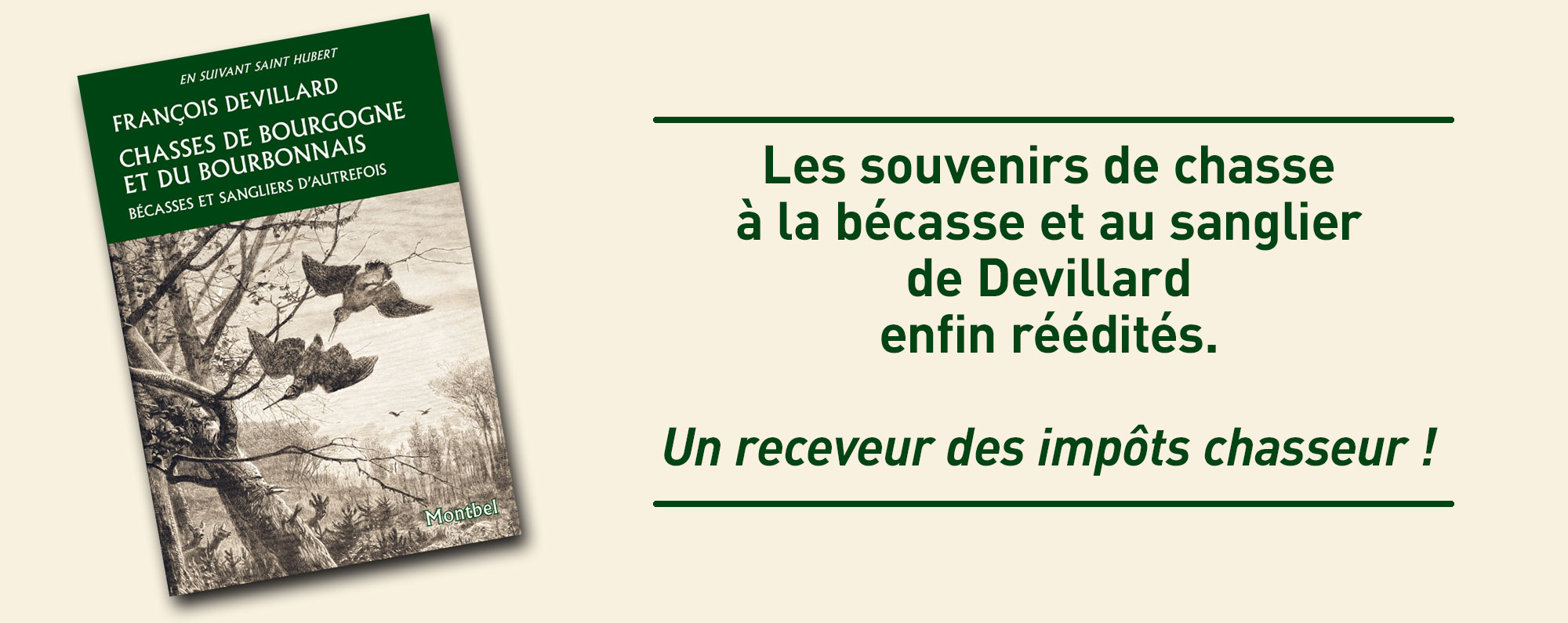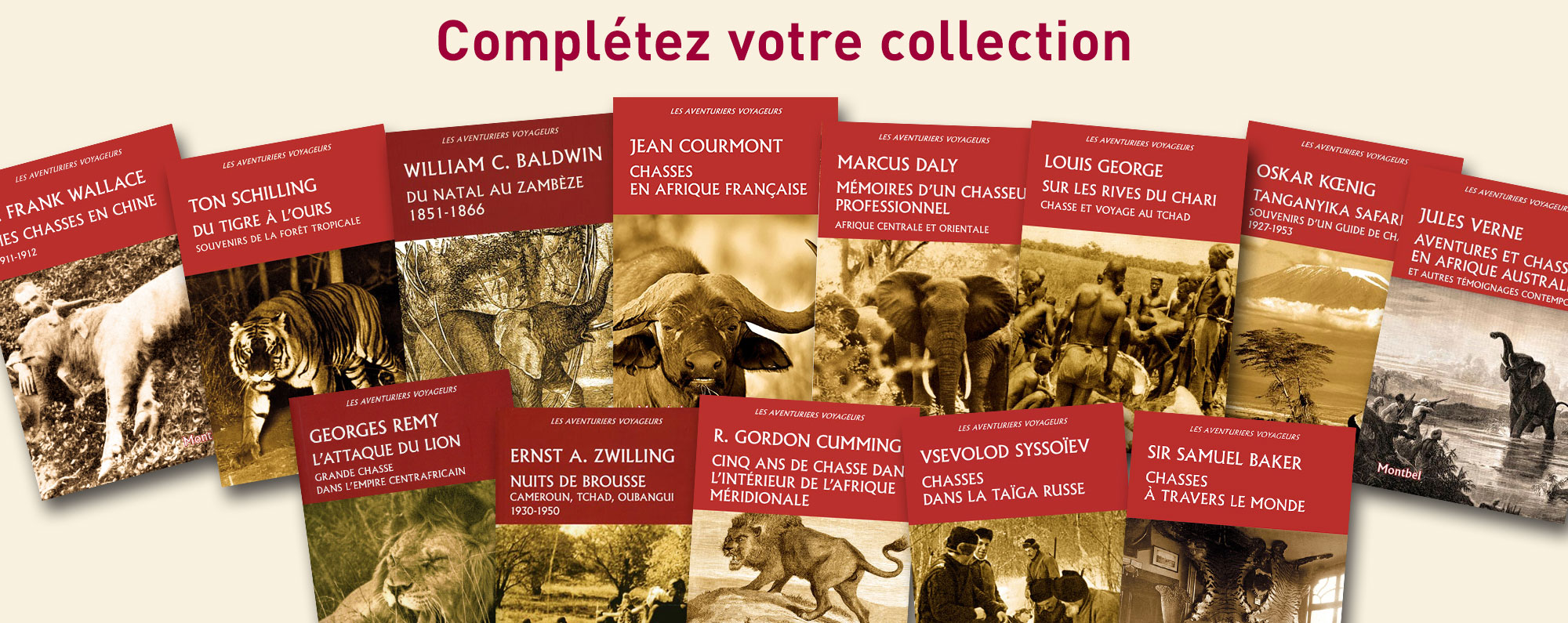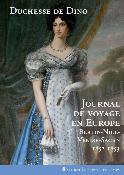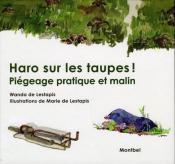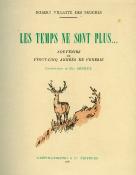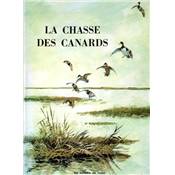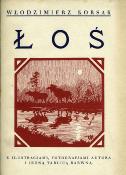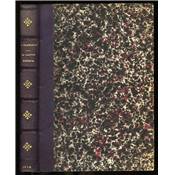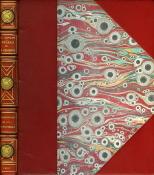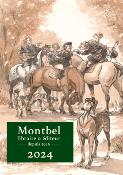Slide Slide Slide Slide Depuis plus de 75 ans à votre servicePremière librairie cynégétique francophone au monde, votre librairie a été entièrement réaménagée à l'occasion de son soixante-dixième anniversaire. Le nouvel espace, véritable cabinet de bibliophilie cynégétique, est conçu pour mieux vous accueillir, mettre en valeur les ouvrages anciens ou de collection et présenter agréablement tous les titres de nos éditions et les plus récentes publications cynégétiques.
C’est à vous, chers clients et amis, que nous devons cette pérennité. Toute l'équipe de la Librairie et des Éditions de Montbel vous remercie donc de votre confiance et de votre soutien et sera toujours heureuse de vous accueillir à Paris et sur les grands salons de chasse.
Soyez les bienvenus du lundi au vendredi, de 9h30 à 19h et les samedis de décembre de 14h à 18h. 8, rue de Courcelles, Paris VIIIe  Choix de livres de collection |